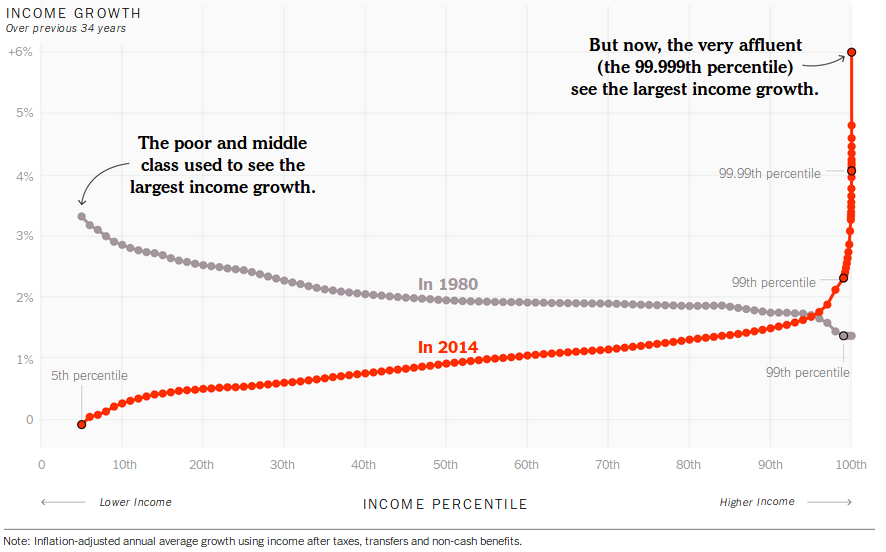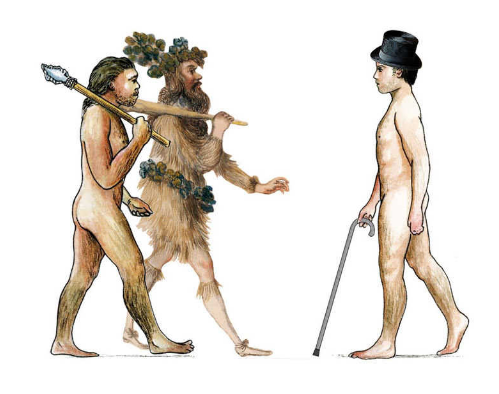L'inégalité est un crime contre l'humanité
Soumis par José le jeu, 10/08/2017 - 14:40 Cet article de la revue Nature (en anglais) est tout à fait explicite : la pauvreté obère le développement du corps et de l'esprit, dès les premières semaines du nourrisson.
Cet article de la revue Nature (en anglais) est tout à fait explicite : la pauvreté obère le développement du corps et de l'esprit, dès les premières semaines du nourrisson.